La Société d’Histoire de la Naissance a perdu sa première présidente et sa cofondatrice. Les années passant, Yvonne Knibiehler avait fini par nous sembler, à toutes et tous, au sein de la Société et dans les multiples sociétés savantes et associations auxquelles elle avait contribué, éternelle.
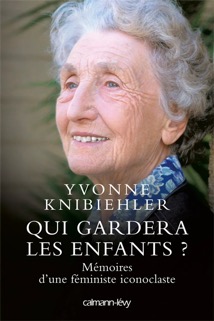
Née en 1922 à Montpellier, Yvonne Knibiehler a mené plusieurs carrières en une vie : professeure agrégée d’histoire (1945), docteure d’État (1970), professeure à l’université d’Aix-en-Provence (1972), fondatrice du Centre d’Études féminines de l’université de Provence et initiatrice des premiers enseignements d’histoire des femmes en France avant même le cours lancé à Paris sous les auspices de Michelle Perrot, Fabienne Bock et Pauline Schmitt-Pantel, enfin membre active et fondatrice de plusieurs associations et sociétés savantes dont la Société d’Histoire de la Naissance fut, avec Demeter-Koré, une des petites dernières.
En 2018, au seuil de sa 97e année, elle nous écrivait pour nous dire son regret de ne plus pouvoir assister aux journées d’étude de la SHN, et, avec modestie, remerciait de « [l’]avoir associée à [nos] activités pendant de longues et belles années ».
Yvonne Knibiehler a marié pendant toute son existence passion pour la recherche et intense sensibilité aux enjeux sociaux de son époque. Jeune professeure agrégée, après cinq ans d’enseignement au Maroc, elle publie une première étude sur l’industrie houillère marocaine (1956), sujet au premier abord bien éloigné de ceux qui occuperont la majeure partie de sa vie de chercheuse, mais révélateur de sa capacité d’observation du monde qui l’entoure et à se saisir des questions sociales contemporaines. Cette expérience du terrain colonial nourrit a posteriori son ouvrage de 1985, coécrit avec Régine Goutalier et intitulé La femme au temps des colonies. Sa thèse de doctorat d’État, consacrée à l’historien aixois François-Auguste Mignet, est, paradoxalement, sa dernière contribution à une histoire politique et littéraire « classique ». La future grande spécialiste de l’histoire des femmes y puise toutefois une connaissance aiguisée du premier XIXe siècle qui éclaire ses deux grands articles publiés en 1976 respectivement dans les Annales (« Les médecins et la « nature féminine » au temps du Code civil ») et dans Romantisme (« Le discours sur la femme : constantes et ruptures »). Le croisement entre regard médical et statut social et politique des femmes devient un des fils rouges de l’œuvre qu’elle tisse de la fin des années 1970 à 2019.
L’une des caractéristiques de cette œuvre est l’attachement à l’écriture à plusieurs mains qu’Yvonne Knibiehler a pratiqué avec régularité pendant toute sa carrière : citons, entre de multiples autres, les travaux avec Catherine Fouquet (Histoire des mères : du Moyen Âge à nos jours, 1982 ; La femme et les médecins : analyse historique, 1983) et bien sûr, un ouvrage cher au cœur de la SHN, La naissance en Occident, coécrit avec Paul Cesbron (2004). Ce goût pour le travail collectif s’est traduit jusqu’à un de ses derniers articles, coécrit avec Zoé Dubus, issu d’une enquête sur les « childfree » publiée dans la revue Sextant, que cette dernière était venue présenter à la SHN.
Cette « féministe iconoclaste » a exploré de nombreux champs de recherche, des représentations d’une « nature féminine » éminemment culturelle, politique et sociale, aux injonctions pesant sur la féminité (La virginité féminine : mythes, fantasmes, émancipation, 2012). Elle a également consacré une grande partie de ses travaux à l’étude des professions de santé à dominante féminine (infirmières, sages-femmes) et à celle de la parentalité (son dernier ouvrage, paru en 2019, s’intitule Réformer les congés parentaux : un choix décisif pour une société plus égalitaire).
La Société d’Histoire de la Naissance dit toute sa gratitude à Yvonne Knibiehler pour son action décisive et l’ensemble de ses travaux. Elle présente ses très sincères condoléances à la famille d’Yvonne et à tous ses proches.
Nathalie Sage Pranchère, présidente de la SHN
En 2011, Marie-France rendait hommage à Yvonne Knibiehler, à l’occasion d’une table ronde consacrée à ses travaux. Nous reproduisons ci-dessous sa contribution parue dans Sylvie Clair dir., Table ronde autour d’Yvonne Knibiehler, pionnière de l’histoire des femmes, Marseille, Archives de Marseille, 2011.
J’ai l’occasion de travailler avec Yvonne Knibiehler depuis la création de la Société d’Histoire de la Naissance en 2001. Fondée par Paul Cesbron, gynécologue-obstétricien exerçant à l’hôpital de Creil et passionné par l’histoire, et par Yvonne Knibiehler (qui en a assumé la présidence jusqu’en 2005), cette jeune société savante présente l’originalité de faire se rencontrer des chercheurs en sciences humaines (historiens, anthropologues, sociologues, philosophes) et des personnels de santé (gynécologues, obstétriciens, sages-femmes, puéricultrices, infirmières), tous concernés par l’histoire de la naissance et les mutations contemporaines des manières de naître. Parmi la centaine de membres de la Société, les chercheurs en sciences humaines sont moins nombreux que les personnels de santé, et ce sont les sages-femmes qui forment la plus grande partie de nos adhérents.
La Société organise à Paris quatre journées d’études par an autour de communications portant aussi bien sur le passé que sur le présent. Les discussions des exposés sont souvent animées, et Yvonne, toutes les fois qu’elle a pu être présente (malgré l’éloignement d’Aix par rapport à Paris), y a toujours participé avec la vigueur qu’on lui connaît. Avec ses talents d’organisatrice et son esprit de synthèse, elle a aussi pris une grande part dans la préparation des trois colloques que la Société a organisés. Le premier, en septembre 2002, a célébré le cinquantième anniversaire de l’accouchement sans douleur. Autour des derniers témoins qui ont vécu l’aventure de l’ASD aux côtés de Fernand Lamaze, se sont réunis ceux qui souhaitaient réfléchir aux mutations des pratiques de la naissance depuis cinquante ans. En septembre 2004, un deuxième colloque à la faculté de médecine de Nantes avait pour thème « Les sages-femmes d’hier à aujourd’hui, pour quel avenir ? ». Il portait sur l’histoire du métier de sage-femme en France et à l’étranger et s’interrogeait sur les conditions actuelles de l’exercice du métier. Un troisième colloque a eu lieu les 22 et 23 septembre 2007 à Châteauroux, sur un thème particulièrement cher à Yvonne, « Féminisme et naissance ». Il s’agissait d’étudier, d’hier à aujourd’hui, les liens souvent ambigus entre les mouvements féministes et le vécu des femmes pendant la grossesse et la naissance.
En 2001, en vue de la préparation du colloque sur l’histoire des sages-femmes, Yvonne a décidé de rédiger un questionnaire à destination des sages-femmes de générations différentes, retraitées, en exercice ou encore élèves dans les écoles, avec l’idée d’effectuer auprès des sages-femmes le même travail de collecte de données qu’elle avait fait pour les assistantes sociales. Elle m’a soumis ce questionnaire (portant à la fois sur les origines familiales, la formation et l’exercice du métier) avant sa publication et je n’y ai apporté que quelques retouches mineures, tant il était déjà complet. Le questionnaire est paru en mai 2003, dans le numéro 316 des Dossiers de l’Obstétrique, une des revues professionnelles de sages-femmes dont la Société est proche, et qui est orientée vers une critique raisonnée de l’hypermédicalisation. Par le biais de la revue, Yvonne a reçu une soixantaine de témoignages, ce qui est peu si on considère qu’il y a environ 12 000 sages-femmes qui exercent en France. Yvonne a fait état des premiers résultats de ce questionnaire lors du colloque de la Société à Nantes. Elle aurait pu en rester là. C’était mal la connaître. Très vite, elle a cherché à recueillir d’autres témoignages en contactant des sages-femmes autres que les abonnées aux DO, en sollicitant d’autres revues, en frappant à la porte des écoles, en collectant des mémoires publiés ailleurs par d’anciennes sages-femmes. Elle a rencontré quelques difficultés, la plus inattendue étant celle de l’Ordre des sages-femmes, protestant parce que certaines questions (sur les croyances religieuses par exemple), étaient trop intimes et pouvaient être contraires à la loi « Informatique et libertés » ; le différend s’est finalement réglé, en insistant sur le fait que le questionnaire n’était qu’une trame assez lâche, pour inciter au témoignage, et que les réponses (ou les non réponses) étaient absolument libres. Cette deuxième moisson a apporté à Yvonne de nouveaux témoignages, souvent longs et riches, qui lui ont permis de démarrer la rédaction du livre Accoucher. Femmes, sages-femmes et médecins depuis le milieu du XXe siècle (ENSP, 2007). En historienne chevronnée qu’elle est, elle a tenu à ne pas se fier exclusivement aux témoignages collectés, si beaux soient-ils. Elle s’en explique à la page 7 de l’ouvrage :
« Aux yeux des historiens, les témoignages personnels ne constituent pas des sources sûres : le mémorialiste reconstruit souvent le passé en fonction du présent, et privilégie, consciemment ou non, ce qui le valorise. En outre, ici, les témoins font manifestement partie d’une élite ; elles ne représentent pas l’ensemble de la profession, elles en donnent une image embellie. Pour équilibrer, il faudrait interroger les accouchées et leurs familles, ainsi que les divers partenaires professionnels des sages-femmes. D’autres le feront. En attendant, ces textes, tels qu’ils sont, posent des questions existentielles que l’on pourra suivre comme des fils rouges tout au long des chapitres. »
Yvonne ne s’est pas contentée des témoignages, auxquels elle rend un bel hommage, puisqu’à travers de longues citations, ils constituent la sève de son livre. Elle a voulu faire un véritable livre d’histoire en replaçant ces témoignages dans l’histoire institutionnelle de la profession. Les notes discrètes qui émaillent le bas des pages, disent l’ampleur de ses investigations : débats des assemblées, textes de lois, enquêtes de la DREES, de l’INSERM, ouvrages de sociologie ou d’histoire. Au total, son livre rend hommage aux sages-femmes d’hier et d’aujourd’hui, en montrant les mutations profondes qui ont affecté la profession depuis les cinquante dernières années. En particulier, il rend compte pour la première fois des grèves de sages-femmes en 1999 et 2001, mouvement tout à fait original et parfois mal compris.
Enfin, si le livre d’Yvonne Knibiehler est un livre d’histoire, c’est aussi, comme bon nombre de ses ouvrages, un livre militant dans le bon sens du terme. Dans son dernier chapitre, « Déceptions et espérances », elle revient sur les inquiétudes et les revendications des sages-femmes actuelles : refus de l’hyperindustrialisation de la naissance des grandes maternités devenues des « usines à bébé » ; désir d’une autonomie plus grande qui leur permette de suivre les femmes d’un bout à l’autre de leurs grossesses ; volonté d’ouvrir des maisons de naissance (hélas sans cesse refusées pour de multiples raisons). En féministe attachée à l’expérience centrale de la naissance dans la vie des femmes, Yvonne Knibiehler est persuadée que seule la mobilisation des « usagers de la naissance » aux côtés des sages-femmes pourra influencer dans le bon sens les évolutions futures des manières de naître.
Je voudrais terminer cette brève présentation par la mention de la modestie et de la générosité d’Yvonne. Dans un premier temps, elle souhaitait que son nom ne figure par seul sur la couverture, car elle disait que ce livre avait été l’œuvre de tous ceux qui l’avaient aidée à le construire. Il a fallu la persuader que c’était bien elle seule qui avait fait le gros travail de mise en œuvre et de recherches complémentaires. Ajoutons qu’elle a insisté pour que le livre soit sorti pour notre troisième colloque en septembre dernier, afin que les centaines de sages-femmes qui y assistaient puissent l’acheter. Ce n’était pas de sa part un souci mercantile, mais découlait de la conviction (qui lui est véritablement chevillée au corps dans toutes ses recherches) que la connaissance de son histoire permet à chaque groupe humain de prendre conscience de lui-même et d’aller de l’avant. Elle l’écrit à nouveau en introduction de ce livre (page 7) : « L’histoire rend aux groupes sociaux un service comparable à celui que la psychanalyse rend aux individus : elle élucide la mémoire, pièce maîtresse de l’identité. » Dans le même esprit, elle n’a pas voulu toucher de droits d’auteur et a demandé à ce que, à la place d’une somme d’argent, l’éditeur donne une centaine d’ouvrages à la Société, pour qu’ils soient distribués à tous ceux qui l’avaient aidée à collecter les données. Au nom de la Société d’Histoire de la Naissance que je préside maintenant après elle. Qu’elle en soit ici remerciée.
Marie-France Morel, historienne de la naissance et de la petite enfance, présidente de la Société d’Histoire de la Naissance.
