LES COMPAGNONS DU FŒTUS (PLACENTA, LIQUIDE AMNIOTIQUE, MEMBRANES,
CORDON OMBILICAL) D’HIER A AUJOURD’HUI
Aubervilliers, Centre des colloques (auditorium 150), 5 et 6 juin 2026
La Société d’Histoire de la Naissance lance un appel à contribution pour son prochain colloque « Les compagnons du fœtus (placenta, liquide amniotique, membranes, cordon ombilical), d’hier à aujourd’hui », colloque qui se tiendra les 5 et 6 juin 2026 au centre des Colloques du campus Condorcet à Aubervilliers.
Les propositions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2025 (voir modalités ci-dessous).
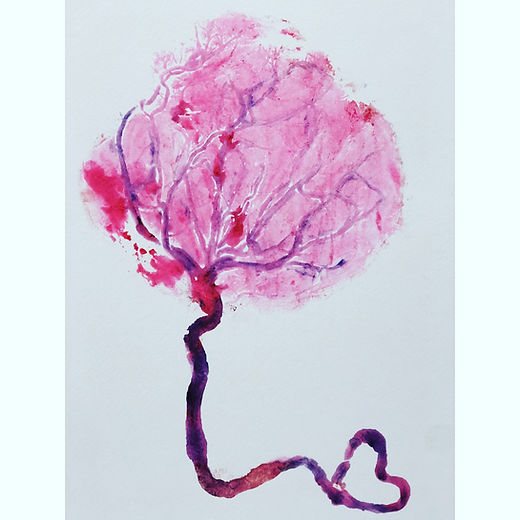
Ouvert aux chercheurs/ses en SHS et aux professionnel·le·s de santé, ce colloque vise à explorer sous l’angle historique autant qu’anthropologique, sociologique, médical, biologique ou juridique la place matérielle et symbolique tenue par les « compagnons du fœtus » : le placenta, le cordon ombilical, les membranes ou encore le liquide amniotique.
Bébés lotus, don de sang de cordon, recueil du liquide amniotique comme réservoir de savoirs sur le fœtus, sa santé et son développement, toutes ces pratiques, d’origine profane ou scientifique, disent l’importance tenue par les “compagnons du fœtus” dans nos sociétés contemporaines. Qu’elles suscitent critiques, railleries et inquiétudes autant qu’espoirs et recherches, elles entrent en résonnance avec des pratiques sociales ou religieuses anciennes, avec des visions diverses des mécanismes de la conception, de la nature de l’humain en devenir ou du naissant.
La littérature existante sur ces annexes fœtales est dispersée et accorde au placenta une place centrale, au détriment des autres “compagnons du fœtus”, même si quelques études font une petite place aux rites entourant le cordon ombilical (Amin, 2005, sur l’Inde du nord au Moyen Âge ; Abua et alii, 2023) ou aux membranes (Belmont, 1971, sur les enfants nés coiffés). Le placenta a ainsi été envisagé dans ses représentations et ses usages (rituels, médicaux, pharmaceutiques) à différentes époques : de l’Antiquité (Bonnet-Cadilhac, 1997 ; Papaikonomou, Huysecom-Haxhi, 2009) au Moyen Âge (Faure, 2016 et Brotons, 2022, sur le Japon), et à l’époque moderne (Gélis, 1984 ; Wahrig, 2011 ; Donaghy, 2023) et contemporaine (De Witt, 1959 ; Benirschke, 1991 ; Longo, Reynolds, 2009). Il est un objet privilégié de l’anthropologie, qu’elle se déploie sur des terrains européens (Tillard, 2004 ; Santoro, 2011) ou extra-européens, de la Polynésie (Bonnemère, 2000 ; Saura, 2000) au monde andin (Davidson, 1983) en passant par le Burkina Faso (Alfieri, 2010). Quelques biologistes se sont également intéressés à cet objet pour lui-même et dans une approche croisée avec la psychanalyse (Rouch, 1987) ou en l’inscrivant dans une approche vulgarisatrice de l’embryologie (Wolff-Quenot, 2001). La saisie de ces enjeux s’ouvre enfin depuis quelques années aux approches juridiques (Cohen, 2020) et éthiques (Marville et alii, 2010 ; Jeong, 2014 ; Alary, 2016).
Ce colloque ambitionne donc d’élargir la focale en intégrant l’ensemble des annexes fœtales, marquées par ce statut ambivalent, entre organes transitoires et fluides exceptionnels. Nous invitons à explorer savoirs et représentations, pratiques et saisie par le juridique et l’éthique que suscitent les compagnons du fœtus de l’Antiquité à nos jours et sur des territoires géographiquement aussi divers que possible.
Voici les différents axes que nous aimerions voir développer à l’occasion du colloque :
- Représentations et savoirs autour des compagnons du fœtus
Un premier axe porterait sur les représentations visuelles ou littéraires de ces compagnons du fœtus, ainsi que sur les savoirs (médicaux, biologiques) dont ils sont le support depuis l’Antiquité. Invisibles pendant le temps de la grossesse, évanescents à l’heure de la naissance ou ne laissant que des traces ténues, les compagnons du fœtus ont suscité des représentations diverses au fil des siècles. De l’omphalos comme substitut de l’enfant Zeus devenu à Delphes le nombril du monde, à la relique du saint nombril du Christ conservée à Châlons-en-Champagne jusqu’à sa destruction par les autorités ecclésiastiques au début du XVIIIe siècle, ou encore aux images du “fœtus au ballon” saisies par le gynécologue-obstétricien et échographiste François Farges, les annexes fœtales peuplent l’imaginaire de l’existence prénatale et du temps de la naissance. Elles éclairent aussi les processus de croissance et de développement du fœtus, et font l’objet de diverses interprétations dans les régimes successifs de scientificité. Cet axe sur les représentations visuelles ou littéraires des compagnons du fœtus peut également inclure des réflexions sur les productions artistiques directement inspirées ou concrètement fondées sur les annexes fœtales (“art placentaire”, etc.). - Pratiques
Au-delà des représentations et des savoirs, les compagnons du fœtus ont suscité des pratiques, qu’elles soient rendues immédiatement nécessaires pour la survie de l’enfant nouveau-né comme la ligature et la section du cordon ou qu’elles éclairent une pensée analogique faisant du placenta le double de l’enfant lorsque celui-ci est enterré au pied d’un arbre nouvellement planté. Ces pratiques émanent des auxiliaires traditionnel·le·s ou professionnel·le·s de la naissance, mais tout autant des parents, des familles ou des membres de la communauté au sein de laquelle naît l’enfant. Elles ont pu donner lieu à des critiques ou des railleries lors du triomphe d’une approche hygiéniste et médicalisée de la grossesse et de la naissance et susciter en retour des réélaborations se réclamant de traditions parfois (ré-)inventées. Les compagnons du fœtus sont également le support de pratiques médicales à visée diagnostique, qu’il s’agisse de l’analyse du liquide amniotique permise par l’amniocentèse ou thérapeutique, que le cordon ombilical se fasse réservoir d’un sang précieux ou que le nombril se mue en voie d’accès au système sanguin du nouveau-né. - Enjeux juridiques et éthiques
Le placenta, le liquide amniotique et le cordon ombilical soulèvent par ailleurs des questions juridiques complexes, touchant au statut de propriété, au consentement ainsi qu’aux usages médicaux ou personnels de ces substances après la naissance. Leur régime et leurs usages diffèrent sensiblement selon les contextes nationaux. En France, aucun droit de propriété n’est reconnu aux parents sur le placenta et le cordon, car ces derniers sont assimilés à des déchets hospitaliers (destinés à être incinérés selon un protocole strict) ou sont utilisés à des fins médicales ou scientifiques. Aux États-Unis la restitution du placenta aux familles est souvent autorisée, comme la conservation privée du sang de cordon, soutenue par un marché en plein essor. Dans certains pays africains et asiatiques, le placenta conserve une forte valeur culturelle et il est souvent récupéré pour des rites religieux ou traditionnels familiaux, en dehors de tout encadrement administratif. L’examen de ces divergences et des débats bioéthiques qu’elles suscitent autour du statut légal et symbolique de ces “compagnons du fœtus” pourra ainsi constituer un des axes de réflexion de ce colloque.
Ce colloque s’inscrit dans une collaboration entre la Société d’Histoire de la Naissance et l’axe Histoire et philosophie de la médecine du laboratoire SPHERE (UMR 7219).
Calendrier :
Les propositions de communications sont à envoyer avant le 30 novembre 2025 à l’adresse suivante : societe.histoire.naissance@gmail.com. Elles devront comporter un résumé de la communication (thème, sources, méthodologie) ainsi qu’une brève présentation de l’auteur/autrice.
Bibliographie :
Abua, Monica Agianipe, Antor Odu, Ndep, Chinweike Madubuattah, Louis, Olushola Ogunkola, Isaac (2023), « Cultural patterns and outcome of umbilical cord care among caregivers in Africa: a systematic review », /Ann. Med. //Surg./ (Londres), Jun 14;85(7), 3553-3356.
Alary, Anouck (2016), « La conservation autologue de sang de cordon ombilical : vers une nouvelle forme de participation biocitoyenne ? », /Les ateliers de l’Ethique/, vol. 11, n°2-3, 28-64.
Alfieri, Chiara (2010), « La divination féminine par le placenta chez les Bobo (Burkina Faso) », /Incidence: philosophie, littérature, sciences humaines/, 6 (311‑316). Consulté à l’adresse hal.science/hal-02572470.
Amin, Shahid (2005), « Un saint guerrier : sur la conquête de l’Inde du Nord par les Turcs au XIe siècle », /Annales. Histoire, Sciences Sociales/, 60 (2), 265‑292.
Belmont, Nicole (1971), /Les Signes de la naissance : étude des représentations symboliques associées aux naissances singulières/, Paris, Plon.
Benirschke, K. (1991), « The placenta in the context of history and modern medical practice », /Arch. //Patrol. Lab. Med./, 115 (7), 663-667.
Bonnemère, Pascale (2000), « Le traitement du placenta en Océanie. Des sens différents pour une même pratique (Commentaire) », /Sciences sociales et santé/. Volume 18, n°3, 29-36.
Bonnet-Cadilhac, Christine (1997), /L’anatomo-physiologie de la génération chez Galien/, thèse pour le Doctorat de l’École Pratique des Hautes Études (IVe section). numerabilis.u-paris.fr/medica/asclepiades/bonnet.php
Brotons, Arnaud (2022), « Pratiques et représentations du pèlerinage dans le Japon médiéval », /Revue de l’histoire des religions/, 239 (4), 679‑695.
Cohen, Mathilde (2020), « The Law of Placenta », /Yale Journal of Law & Feminism/, Vol. 31, 337-409.
Davidson, Judith (1983), « La sombra de la vida: la placenta en el mundo andino », /Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines/, tome 12, N°3-4, 69-81.
De Witt, Foster (1959), « An Historical Study on Theories of the Placenta to 1900 », /Journal of the History of Medicine and Allied Sciences/, Vol. 14, n° 3, 360-374.
Donaghy, Paige (2023), « The Secrets of the Placenta in European Anatomy and Midwifery, 1560–1700 », /Isis/, 114 (2), 249‑271.
Faure, Bernard (2016), « La part d’ombre du bouddhisme : dieux et démons du Japon médiéval », /Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres/, 160e année, N. 3, 1381-1394.
Gélis, Jacques (1984), /L’arbre et le fruit. La naissance dans l’Occident moderne, XVIe-XIXe siècle/, Paris, Fayard.
Jeong, Yeonbo (2014), « Scientific Motherhood, Responsibility and Hope: Umbilical Cord Blood Banking in South Korea », /New Genetics and Society/, vol. 33, n° 4, 349-369.
Longo, Lawrence D., Reynolds, Lawrence (2009), « Some historical aspects of understanding placental development, structure and function », /Int. J. Dev. //Biol/., 54, 237-255.
Maire, Brigitte (2007), « Conceptio, retentio et cotylédon ou quelques aspects de la vie intra-utérine » in Véronique Dasen (dir.), /L’Embryon humain à travers l’histoire. Images, savoirs et rites/, Infolio, 207-222.
Marville, Laurent, Haye, Isabelle, Reinhart Marville, Torre, Katz, Grégory (2010), « Quel statut pour les banques de sang de cordon ombilical ? », /Médecine et droit/, vol. 2010, n°102, 81-85.
Papaikonomou, Irini-Despina, Huysecom-Haxhi, Stéphanie (2009), « Du placenta aux figues sèches : mobilier funéraire et votif à Thasos », /Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique/, (22), 133‑158.
Méhats, Céline, Marcellin, Louis, Schmitz, Thomas (2018), « Une activation immunitaire à l’interface fœto-maternelle précède la parturition humaine », /Med Sci/, vol 34, 208-210.
Rouch, Hélène (1987), « Le placenta comme tiers », /Langages/, No. 85, Le sexe linguistique, 71-79.
Santoro, Pablo (2011), « Liminal Biopolitics: Towards a Political Anthropology of the Umbilical Cord and the Placenta », /Body and Society/, vol. 17, n°1.
Saura, Bruno (2000), « Le placenta en Polynésie française : choix de santé publique et identité », /Sciences sociales et santé/, Volume 18, n°3, 5-28.
Tillard, Bernadette (2004), « Le placenta : entre oubli familial et investissement médical », /Face à face. Regards sur la santé/, (6). Consulté à l’adresse journals.openedition.org/faceaface/371.
Wahrig, Bettina (2011), « Human Placenta in Premodern Europe – a Cultural and Pharmaceutical Agent », /Berichte zur Wissenschaftsgeschichte/, Volume 47, n°4, 396-417.
Wolff-Quenot, Marie-Josèphe (2001), /In Utero. Mythes, croyances et cultures/, Paris, Masson.

One comment on “Prochain colloque de la SHN. Appel à communications”
Comments are closed.